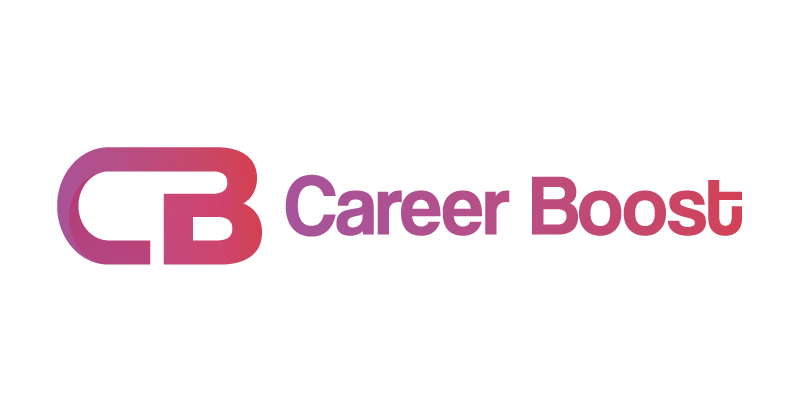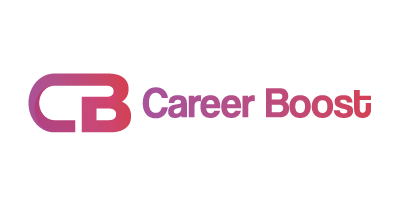Un volume double ne s’accompagne pas toujours d’une masse doublée. Certaines grandeurs physiques restent inchangées, même si la taille du système varie. D’autres, au contraire, évoluent en fonction de l’ampleur du système concerné. Cette distinction structure la compréhension des propriétés des systèmes physiques. Elle intervient dans la formulation des lois fondamentales et dans le choix des paramètres lors de l’analyse expérimentale.
Comprendre les notions d’extensivité et d’intensivité en physique
Dans l’univers des systèmes thermodynamiques, différencier grandeur extensive et grandeur intensive n’a rien d’anecdotique. Une grandeur extensive évolue selon la quantité de matière ou l’échelle du système : doublez la masse, le volume ou l’énergie, vous doublez aussi leur valeur respective. Dès qu’on additionne deux systèmes identiques, leurs propriétés extensives s’additionnent, sans ambiguïté.
Les grandeurs intensives, elles, ignorent la taille du système. Température, pression, concentration : ces indicateurs gardent leur valeur, qu’on divise ou qu’on rassemble des ensembles similaires. On les retrouve invariables à chaque étape d’une étude d’équilibre, d’une transition ou d’une transformation. Même sous les yeux du chercheur, ces variables intensives restent solidement ancrées, imperméables aux variations de grandeur autour d’elles.
Tableau synthétique
| Variables extensives | Variables intensives |
|---|---|
| Masse, volume, énergie, entropie | Température, pression, densité, concentration |
Cette distinction nourrit la réflexion en thermodynamique. L’énergie interne, grandeur extensive, répond à la pression, grandeur intensive, dans l’analyse d’échanges et d’états. Si l’on prend la masse volumique, elle résulte du rapport entre la masse et le volume, tous deux extensifs, mais devient une propriété intensive. Ce jeu d’écriture montre que le classement va bien plus loin qu’une simple catégorisation : il influence la manière même de saisir, classer et mesurer les propriétés physiques des matériaux ou des fluides.
Pourquoi distingue-t-on grandeurs extensives et intensives ?
Séparer les grandeurs extensives des intensives, c’est poser les fondements de toute étude sérieuse sur un système thermodynamique. Dès que l’on cherche à comprendre l’évolution des propriétés d’un système, cette grille de lecture s’impose.
Les propriétés extensives (masse, volume, énergie) évoluent avec la quantité de matière. Ajoutez du volume, augmentez la masse, ces variables grimperont d’autant. À l’opposé, les variables intensives comme la température ou la pression ne dépendent pas du volume total. Par exemple, réunir deux réservoirs d’eau à la même température n’affectera en rien cette dernière. Cette scène simple résume toute la logique d’une variable intensive.
Dans la modélisation, cette différenciation devient indispensable. Elle aide à anticiper comment un ensemble réagit lorsqu’il grossit, se fragmente ou interagit. Les physiciens s’appuient sur ce repère pour choisir leurs équations, configurer leurs appareils ou garantir la cohérence de leurs modèles. Cette séparation structure la manière d’appréhender tout système de grande taille dans un contexte thermodynamique.
Quand on décrit un système, les grandeurs extensives reflètent son étendue globale, alors que les intensives caractérisent ses propriétés locales. Cette répartition permet de construire des lois fiables, capables d’ordonner la matière et l’énergie à l’échelle macroscopique.
Exemples concrets pour illustrer chaque type de grandeur
Pour rendre tangibles ces notions, il suffit d’observer ce qui se passe au laboratoire. Dès qu’on verse un liquide dans un récipient, la masse grimpe au fur et à mesure de chaque ajout. Voilà la marque d’une variable extensive. Idem pour le volume ou l’énergie interne : combiner deux sous-systèmes identiques, c’est additionner mécaniquement leurs propriétés extensives.
D’autres grandeurs, à l’inverse, restent sourdes à la quantité de matière. Température, pression, viscosité : ces variables intensives traduisent l’état local du fluide, indépendamment de sa masse totale. Si l’on fusionne deux volumes d’eau identiques, la température reste figée, elle ne bougera pas.
La masse volumique est un bon exemple : née du rapport masse/volume, elle se comporte comme une propriété intensive, qu’on la mesure sur une faible quantité de liquide ou sur une réserve entière.
Quelques exemples permettent de mieux visualiser cette dualité :
- Grandeurs extensives : masse, volume, énergie interne, entropie, nombre de particules.
- Grandeurs intensives : pression, température, viscosité, masse volumique.
En thermodynamique, cette distinction guide la sélection des variables pour modéliser n’importe quel système. L’énergie interne extensive d’un gaz suivra toujours la quantité présente, tandis que la température, propriété intensive, sert de marqueur d’équilibre et ne dépend ni de la masse ni du volume.
Les implications de cette distinction dans l’étude des systèmes physiques
En thermodynamique, faire le distinguo entre grandeurs extensives et intensives n’a rien d’accessoire. Cela détermine la manière d’aborder les bilans, les équilibres et tout calcul lié aux lois de la physique.
Le principe de conservation de l’énergie s’applique à une grandeur extensive. Quand on fusionne deux systèmes, les énergies s’additionnent, collant avec l’expérience. Le principe zéro de la thermodynamique s’intéresse à l’équilibre thermique : la température, grandeur intensive, tend à s’uniformiser entre systèmes au contact, peu importe leur taille respective. Cette opposition façonne toute l’analyse.
La deuxième loi de la thermodynamique met l’accent sur l’entropie. Dès qu’on réunit deux sous-systèmes, l’entropie, propriété extensive, s’accroît. Pourtant, le sens des évolutions irréversibles s’exprime via le gradient d’entropie, une mesure intensive. Ce jeu d’échelle impose de toujours distinguer ce qui relève du tout et ce qui décrit le local.
Jusque dans les modèles de mécanique quantique, la différence tient la route. Dans un système de particules, nombre de particules et énergie s’additionnent (extensives), tandis que pression et densité de probabilité (intensives) ne dépendent pas du nombre total. Cet éclairage traverse le laboratoire, les formules et même l’infiniment petit.
Au final, grandeurs extensives ou intensives dessinent chacune un visage de la réalité physique. Savoir jongler avec cette dualité, c’est garder une boussole fiable pour explorer la matière, et oser franchir les frontières du connu.